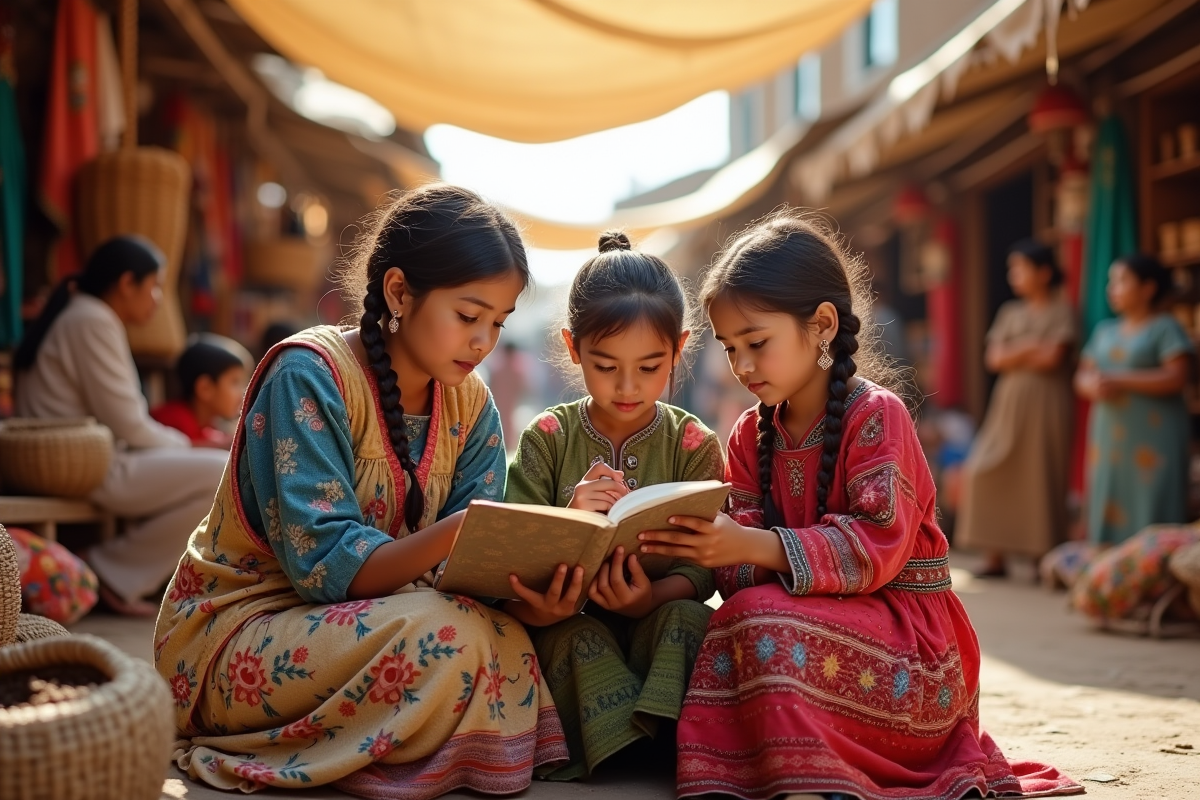Dire que le romani est la langue des « sans-papiers linguistiques » n’a rien d’exagéré : aucun État européen n’a jamais gravé ce parler dans ses lois, malgré plus d’un millénaire d’histoire sur le continent. Son vocabulaire puise profondément dans les sources indiennes, mais chaque étape migratoire l’a métissé, du persan au grec, du roumain au français.
Certains locuteurs glissent d’un dialecte à l’autre avec une facilité déconcertante, brouillant les repères sur lesquels s’appuient les spécialistes. Comme aucune norme commune n’a vu le jour, une constellation de variantes s’est développée, parfois si éloignées qu’elles deviennent mutuellement inintelligibles.
La langue romani, un patrimoine vivant et méconnu
La langue des gitans, qu’on appelle aussi romani ou rromani, va bien au-delà d’un simple outil pour échanger. Elle porte la mémoire d’un peuple, transmise oralement de génération en génération, chez les gitans, Roms, Sinte et d’autres groupes tsiganes. Issue de la grande famille des langues indo-aryennes, elle s’est façonnée au fil des routes et des rencontres, gardant des racines indiennes tout en se nourrissant d’innombrables influences. Le terme « rromani » désigne à la fois la langue et l’identité de ceux qui la préservent.
À chaque étape, le romani s’est enrichi de mots venus du persan, du grec, du roumain, du français et bien d’autres horizons. Grammaire et vocabulaire racontent une histoire de voyages, de rencontres, de transformations depuis l’Inde du Nord jusqu’aux terres d’Europe occidentale. N’ayant jamais été officielle nulle part, la langue s’est ramifiée avec le temps, multipliant les variantes sans jamais perdre son caractère distinct.
Dans de nombreux pays, la langue tsigane agit comme rempart face à l’assimilation et marque forte d’une identité partagée. Pourtant, elle reste invisible à large échelle, y compris en France où coexistait déjà une multitude de formes de langue gitane. Dans le sillage des efforts associatifs pour sa reconnaissance, c’est encore souvent la transmission familiale qui fait vivre la langue. Ce paysage linguistique foisonnant, miroir direct de l’histoire des rroms en Europe, force à voir le romani comme un patrimoine vivant en constante mutation.
Quels sont les principaux dialectes parlés par les Gitans ?
Cette diversité linguistique vient d’un long chemin migratoire et d’une capacité d’adaptation exceptionnelle. Pas une seule langue gitane : une mosaïque de dialectes du romani, transformés au fil des rencontres et de l’histoire.
Certaines variantes se distinguent nettement. Le caló, caractéristique de la péninsule ibérique, se nourrit d’un vocabulaire indo-aryen combiné à une grammaire espagnole. En Catalogne, le caló catalan prolonge cette hybridation, témoin d’une grande perméabilité linguistique au fil du temps.
Plus au nord, le kalo du Pays de Galles, aussi appelé romani gallois, s’accroche encore dans certains foyers, même si son usage a reculé. L’anglo-romani, typique du Royaume-Uni, mélange l’anglais avec le lexique romani. A l’Est, les variétés balkaniques conservent leur originalité, marquées par les influences grecques, roumaines, bulgares, tout en gardant cette continuité du fil indo-aryen.
Pour mieux comprendre la richesse de ces parlers, on peut retenir quelques grandes variantes :
- Caló : utilisé en Espagne et au Portugal, fusionne espagnol et racines romani
- Kalo : propre au Pays de Galles, porte l’héritage indo-aryen
- Anglo-romani : au Royaume-Uni, mêle structures grammaticales anglaises et mots tsiganes
- Romani des Balkans : présent en Europe centrale et orientale avec de grandes différences d’une région à l’autre
Les Sinte d’Allemagne, d’Autriche ou de Suisse emploient pour leur part le romanès sinti, où les apports germaniques abondent. Les dialectes gitans changent, évoluent, au gré des contacts : c’est une langue qui ne tient jamais en place et tire sa force de l’adaptation permanente.
Histoire et évolutions : comment la langue romani s’est transformée au fil des migrations
Les origines de la langue romani remontent au sanskrit du nord de l’Inde. Les ancêtres des Roms auraient quitté la région de Kannauj il y a près de dix siècles, fuyant tensions et conflits. Cette longue migration a laissé son empreinte profonde sur leur langue, qui a su absorber les sons et les mots de chaque étape du parcours.
Au fil des périples, le lexique romani s’est étoffé : influence du persan en Perse, marque du grec à l’époque byzantine jusque dans certaines structures, emprunts aux langues slaves dans les Balkans, comme le bulgare, le serbe ou le roumain. Progressivement, les différences dialectales se sont renforcées, chaque communauté inventant ses propres variantes, selon histoire et enracinement.
Au centre de l’Europe, le romanès s’est imprégné d’allemand, de tchèque ou de hongrois, dessinant d’autres façons de parler chez les Sinte ou les Roms d’Europe de l’Est. La seconde guerre mondiale a accentué les fractures : déplacements forcés, dispersion, perte de la langue dans certains groupes. Malgré cela, le romani reste pour d’innombrables familles un foyer autour duquel l’identité s’est modelée.
Pour y voir plus clair dans toutes ces évolutions, voici les jalons marquants :
- Origines : sanskrit spoke dans le nord de l’Inde (Kannauj)
- Emprunts : persan, grec, langues slaves
- Éclatement dialectal : Balkans, Europe centrale, territoires roumanophones
- Bouleversements du XXe siècle : notamment la Seconde Guerre mondiale
La langue romani montre ainsi, à chaque pas de son histoire, sa capacité à se transformer tout en conservant l’héritage de ses racines indo-aryennes.
Ressources et initiatives pour découvrir et apprendre le romani aujourd’hui
Le romani attire depuis plusieurs années l’attention des chercheurs et associations décidés à sauvegarder ce témoignage linguistique vivant. Partout en Europe, des projets se montent pour encourager la transmission et valoriser ce dialecte spécifique aussi bien auprès des Roms, des Gitans et des Sinti que du grand public curieux.
Le linguiste Marcel Courthiade a ainsi créé à Paris la première chaire universitaire consacrée à la langue rromani. Son équipe propose des outils pratiques : dictionnaires et grammaires, très précieux à la fois pour les familles désireuses de renouer avec leur héritage et pour ceux qui s’intéressent aux minorités linguistiques. De leur côté, de multiples associations continuent d’œuvrer pour faire reconnaître officiellement le romani dans ses différentes variantes.
La littérature romani s’affirme aujourd’hui avec de nouveaux textes, grâce à des auteurs comme Joseph Valet qui explorent la poésie, le récit et le théâtre pour renouveler la culture gitane. Festivals et rencontres à travers la France, le Portugal ou même l’Iran mettent en avant ce patrimoine et contribuent à la faire connaître auprès des jeunes générations.
Pour qui voudrait se lancer ou approfondir, plusieurs ressources existent :
- Ouvrages : livres, dictionnaires, recueils de textes romani, grammaires dédiées
- Formations universitaires à Paris
- Actions et mobilisations associatives pour la reconnaissance de la langue
- Événements et ateliers mettant à l’honneur la littérature et la parole romani
L’atlas des langues en danger de l’UNESCO classe le romani parmi les langues menacées, signe qu’il reste bien du travail avant que cette voix ne s’éteigne. L’histoire reste à écrire : porter la langue romani, c’est défendre un pan vivant d’Europe, contre l’amnésie collective. Le chemin continue, porté par l’audace de celles et ceux qui refusent de la laisser disparaître.